Rennes le château
A proximité du gîte l'Oustal de Marsa, Rennes-le-Château (Rènnas del Castèl en occitan) est une commune française, située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon. Rennes-le-Château a notamment été rendu célèbre par l'un de ses curés, l'abbé Saunière, qui y aurait trouvé un trésor en 1885.
Histoire
Rennes-le-Château a une histoire longue et complexe. Son territoire actuel a été occupé dès la Préhistoire, puis a abrité une colonie romaine et au moyen age le site est devenu une ville fortifié du nom de "Rhedae". C'est pendant cette periode que suite à de nombreux conflits, la ville et ses fortifications disparurent pour laisser place, à l'emplacement de la place forte, au village actuel de Rennes-le-château.
Préhistoire et Antiquité
Les Gaulois fondèrent le premier village, envahi ensuite par les Romains. C'est au VIe siècle, que les Wisigoths développeront et fortifieront le site, qui se transforme en une citadelle sous le nom de Rhedae, la cité des chariots. Place stratégique dominant les Corbières, avec l'avancée des Francs, la place forte est devenue une ville fortifiée.
Moyen Âge
À l'époque de Charlemagne, la ville aurait été le siège du royaume wisigoth du VIe et VIIe siècle mais il n'y a aucune preuve de ce point. Le site est composé d'une citadelle fortifiée "le castrum de Rhedae", et à son pied, la ville est entourée par des remparts reliés au castrum. A cette époque Rhedae aurait eu deux églises, une sous le vocable de Saint Pierre dans la ville et la seconde à la Vierge Marie dans la forteresse à l'emplacement de l'église actuelle. Elle est aussi le chef-lieu du Razès au VIIIe siècle qui devient un comté. Au IXe siècle, le comté est divisé au profit de puissances locales. En 1062, le comté de Rhedae ou Razès est réuni à celui de Carcassonne. Rhedae et le comté du Razès vont être convoités et disputés de manière violente. En 1170, Rhedae appartient au comté de Carcassonne, mais le roi d'Aragon qui revendique le Razès, lance une offensive et détruit en partie la ville et ses fortifications. En 1207, la croisade contre les Albigeois débute et Rhédae, au coeur du pays Cathare, voit la région s'embraser. Simon de Montfort prend et détruit le château de Coustaussa. Les vainqueurs de la croisade se partagent les domaines des seigneurs vaincus et le comté du Razès est attribué en partie à Pierre de Voisins. En 1293, Pierre II de Voisins, va remettre en état les fortifications de Rhédae, la ville compte quelques centaines d'habitants et reste encore de taille importante pour l'époque. Commence alors une période de prospérité. La ville se développe, le commerce et la population augmentent. La famille De Voisins restera maître de Rhédae jusqu'en 1362. En 1362, Henri de Trastamare : Henri II de Castille, à la tête d'une bande de pillards surnommés les routiers aragonnais, ravage et pille le Razès. Les pillards mettent le siège devant Rhèdae, qu'ils prennent et détruisent ne laissant derrière eux que des ruines. C'est à cette date que la ville disparait. Sur le plateau, seules restent quelques bâtisses épargnées et la structure du château qui a résisté à la destruction. La ville ne retrouvera jamais son importance et, dépourvu de fortifications, le lieu va laisser place à un village. Le comté de Razès passe en 1422 à la maison d'Hautpoul, originaire d'Aussillon près de Mazamet, par le mariage de Pierre-Raymond d'Hautpoul avec Blanche de Castille, fille de Jeanne de Voisins, descendante de Pierre II de Voisins à qui le Razès avait été inféodé en 12301.
Époque moderne et contemporaine
François d'Hautpoul (1689-1753) releva le titre de marquis de Blanchefort tombé en désuétude, que lui apporta en dot son épouse Marie de Nègre d'Ables (1714-1781), dame de Niort, de Roquefeuil et de Blanchefort. L'abbé Saunière arrive au village de Rennes-le-Château en 1885. Le village est pauvre, isolé, et ne compte que 200 habitants. L'église est délabrée, la toiture est percée, la pluie a fait des ravages à l'intérieur et le presbytère est invivable. En 1886, suite à de nombreux dons, l'abbé entame une série de rénovations les plus urgentes dont la toiture de l'église du village afin de ne plus être incommodé par les intempéries lors des offices. En 1887, il décide le remplacement de l'autel. Lorsque les ouvriers déplacent la pierre de l'autel très ancienne, ils découvrent une cache sur l'un des piliers contenant des rouleaux de bois scellés à la cire, qui contiennent des parchemins. L'ensemble est remis au curé, qui va tenter de les déchiffrer. Il existe quelques variantes concernant cette découverte, pour certains ces parchemins sont découverts dans la cache d'un balustre en bois, pour d'autres dans un des deux piliers de l'autel. Il y avait deux piliers : un de pierre brut, et le second gravé de symboles mérovingiens ou carolingiens. C'est dans ce dernier que les parchemins auraient été découverts. Ce pilier peut être admiré au musée du village. Pour ce qui concerne les parchemins la mairie réclama des copies, que l'abbé leur transmis. Personne ne sait aujourd'hui, ou n'a la preuve de ce que contenaient concrètement ces parchemins. Peu après cette découverte, L'abbé Saunière veut changer le dallage de l'église et surtout celui devant l'autel. Les ouvriers soulèvent la dalle principale et découvrent sur la face contre le sol un bas-relief magnifique représentant des chevaliers : c'est la dalle des chevaliers. En dessous de cette dalle, une cavité est mise à jour. Les ouvriers remarquent alors des pièces de monnaies "en or?" dans un récipient. Le prêtre les congédie immédiatement, invoquant que ce ne sont que des médailles de Lourdes sans valeur et qu'ils doivent se restaurer pour reprendre les travaux dans l’après midi. Lorsque les ouvriers reviennent, Béranger leur stipule qu'il n'a plus besoin d'eux. Le curé restera enfermé dans son église toute la journée et les jours suivants. L'attitude de l'abbé change, il entreprit seul les excavations de l'église. Il s'absenta de nombreux mois, la version officielle serait : un voyage à Paris, financé par l’évêque Monseigneur Billard, dans le but de traduire les parchemins. A son retour, L'abbé Saunière a une attitude toujours étrange. Les villageois le voient partir tôt le matin avec une hotte sur le dos vide et revenir le soir chargé de cailloux. De plus, certains le voient fouiller tard la nuit dans le cimetière, déplaçant des pierres tombales, et s'acharnant à effacer certains épitaphes dont celle de Marie de Negri d’Able épouse de François d'Hautpoul dernier seigneur de Rennes le Château. Une plainte est même 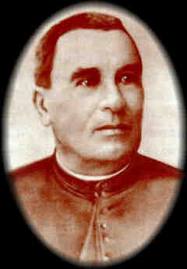 déposée par la mairie. En 1891, dans les carnets personnels de L'abbé Saunière est écrit " découverte d'un tombeau". C'est durant cette année la qu'il va commencer les aménagements extérieurs de l’église en dessinant lui même le parc que l'on peut encore découvrir aujourd'hui malgré les nombreuses destructions qu'il a subit. Il construit aussi la villa Béthanie, la Tour Magdala, une galerie, une tour de verre et des jardins. Une rumeur court sur la découverte d'un trésor par l'abbé Saunière. Depuis, et en particulier après la publication du roman Da Vinci Code, qui reprend des éléments de la rumeur de Rennes-le-Château, le village voit le passage fréquent de curieux ou de soi-disant « spécialistes » qui tentent de percer le mystère de l'abbé. La municipalité a d'ailleurs été contrainte de prendre un arrêté dans les années 1960, interdisant les fouilles sur son territoire. En mars 1981, alors candidat à l’élection présidentielle, François Mitterrand visite le village dont la tour et l’église2 Mystères et énigmes Le mystère de Rennes est avant tout la recherche d'une explication sur les revenus considérables de l'abbé Saunière, qui lui ont permis de mener la grande vie et de financer tout les travaux sur son domaine. Depuis le décès de l'abbé Saunière, les rumeurs concernant la découverte d'un trésor par l'abbé persistent dans le village et les environs. En 1946, Mr Noel Corbu achète le domaine en viager à Marie Denarnaud, et le transforme en restaurant. Pour faire venir les clients, il va alors raconter l'aventure de l'abbé Saunière, ses travaux et surtout l'origine inconnue des ressources financières pour un pauvre curé de campagne. Une évidence déjà tenace depuis de nombreuses décennies mène à la conclusion suivante : celle de la découverte d'un trésor. En mai 1961, la télévision s'intéresse au mystère, ce qui va provoquer un afflux de chercheurs de trésors, déjà nombreux sur les lieux. Gérard De Sède, en 1967 popularise le mystère par son best-seller : l'or de Rennes.
déposée par la mairie. En 1891, dans les carnets personnels de L'abbé Saunière est écrit " découverte d'un tombeau". C'est durant cette année la qu'il va commencer les aménagements extérieurs de l’église en dessinant lui même le parc que l'on peut encore découvrir aujourd'hui malgré les nombreuses destructions qu'il a subit. Il construit aussi la villa Béthanie, la Tour Magdala, une galerie, une tour de verre et des jardins. Une rumeur court sur la découverte d'un trésor par l'abbé Saunière. Depuis, et en particulier après la publication du roman Da Vinci Code, qui reprend des éléments de la rumeur de Rennes-le-Château, le village voit le passage fréquent de curieux ou de soi-disant « spécialistes » qui tentent de percer le mystère de l'abbé. La municipalité a d'ailleurs été contrainte de prendre un arrêté dans les années 1960, interdisant les fouilles sur son territoire. En mars 1981, alors candidat à l’élection présidentielle, François Mitterrand visite le village dont la tour et l’église2 Mystères et énigmes Le mystère de Rennes est avant tout la recherche d'une explication sur les revenus considérables de l'abbé Saunière, qui lui ont permis de mener la grande vie et de financer tout les travaux sur son domaine. Depuis le décès de l'abbé Saunière, les rumeurs concernant la découverte d'un trésor par l'abbé persistent dans le village et les environs. En 1946, Mr Noel Corbu achète le domaine en viager à Marie Denarnaud, et le transforme en restaurant. Pour faire venir les clients, il va alors raconter l'aventure de l'abbé Saunière, ses travaux et surtout l'origine inconnue des ressources financières pour un pauvre curé de campagne. Une évidence déjà tenace depuis de nombreuses décennies mène à la conclusion suivante : celle de la découverte d'un trésor. En mai 1961, la télévision s'intéresse au mystère, ce qui va provoquer un afflux de chercheurs de trésors, déjà nombreux sur les lieux. Gérard De Sède, en 1967 popularise le mystère par son best-seller : l'or de Rennes.
*

